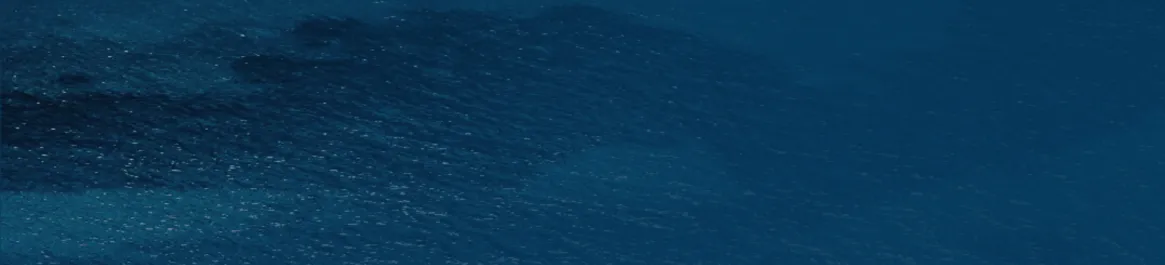
Deskiñ ha Komz Brezhoneg


LE CONDITIONNEL [source*]
Emploi du conditionnel
Le conditionnel potentiel
• En breton, la forme correspondant au français « je voudrais » est normalement le conditionnel potentiel
en -fe, utilisée lorsque la demande du locuteur se présente comme réalisable et s’ouvre prospectivement à l’approbation de l’allocutaire :
Un hanter vagetenn a garfen kaout, posupl eo ? « Je voudrais une demi-baguette, c'est possible ? »
Le conditionnel irréel
• Plus rarement utilisé, l’irréel en -je- produit une hypothèse présentée comme périmée, révoquée, et pour laquelle l’avis de l’allocutaire n’est pas sollicité :
Piv zo barrek da cheñch skridoù en ur skeudenn ? Sed amañ ar skeudenn a garjen treiñ ar gerioù enni : …/…
« Qui est capable de traduire le texte d’une image ? Voici l’image dont j’aimerais traduire le texte : …/…
Le conditionnel avec subordonnée
• Avec une subordonnée, on s’attend à un accord ou une harmonie des modalités :
Me a garje e vije meur a verour oc'h ober war-dro, da glask kaout un emglev ledan.
« J’aimerais qu’il y ait plus de fermiers qui s’y mettent dans le secteur, pour essayer d’avoir une large entente. »
• Cet usage était déjà en vigueur au 19e siècle, comme dans la complainte de Marguerite Le Soaz : quand elle déclare à l’irréel :
Me a garje bezañ marv « j’aimerais être morte »
- une évidence dans sa situation (contexte : elle préfèrerait mourir plutôt que de renoncer à soigner son père lépreux), son père lui répond au potentiel :
* Perak karfec'h be'añ marvet ? « Pourquoi voudrais-tu être morte ? »
Le conditionnel de suggestion
• Lorsque le locuteur avance une suggestion prudente « Ce serait bien de / si :
Mat e vefe brezhonekaat ar forom-mañ evel just « Evidemment ce serait bien parler breton sur ce forum. »
Le conditionnel de valeur instructionnelle
• De la morphologie temporelle à la valeur instructionnelle :
Met mat e vije sikour muioc'h ar re o deus prenet bigi-delien.
« Mais ce serait bien d’aider davantage ceux qui ont acheté des voiliers. »
Protases et apodoses Subordonnée conditionnelle placée avant la principale.
Protase : Subordonnée conditionnelle placée avant la principale.
Apodose : Proposition principale placée après une subordonnée conditionnelle indiquant la conséquence.
(Exemple Si j'insiste [protase], il viendra [apodose].)
Protase au potentiel + apodose au potentiel :
• La condition est un possible ouvert par le locuteur, la conséquence également.
Pegen brav e vefe ma c'hallfe kalz reoù all mont d'e heul
« Qu’est-ce que ce serait bien si beaucoup d’autres pouvaient l’imiter! »
Protase à l’irréel, apodose au potentiel :
m’am bije arc’hant e prenfen an dra-se diouzhtu (hogen, n’em eus ket arc’hant)
« si j’avais de l’argent j’achèterais cette chose-là tout de suite (seulement, je n’ai pas d’argent) »
Ma ouijen skoazellañ e rafen n’eus forzh petra « Si je pouvais aider je ferais l’impossible. »
Protase au potentiel, apodose à l’irréel :
Ma zad neuze ma mamm na vijent ket kontan ma yafen me ganeoc’h.
« Mon père et ma mère ne seraient pas contents si je partais avec toi. »
Protase et apodose à l’irréel :
Ma c'halljen mont ez ajen.
« Si je pouvais partir, je partirais. »
Avec « ha pa » (et quand, quand bien même), tjs suivi de l’un des conditionnels
(même combiné à un futur en apodose) - Hypothèse recevable (potentiel), conséquence garantie :
Ha pa spontfe ar re all, me ne spontin ket.
« Même si les autres ont peur, moi je n’aurai pas peur. »
Hypothèse irrecevable (irréel), conséquence fictive :
Ha spi hoc’h eus da gavout ho preur ?
« Et vous avez l’espoir de retrouver votre frère ? »
Spi ebet. Ha pa’m bije bet spi, e vije aet da get pell ’zo.
« Aucun espoir. Et même si j’en avais eu, je l’aurais perdu depuis longtemps. »
e prenfen… (gellout a ran c’hoaz kaout arc’hant)
« j'achèterais… » (si j’avais assez d’argent)
Les conditionnels potentiel et irréel en breton :
De la morphologie temporelle à la valeur instructionnelle
Evit kaout ur soñj eus ment Koskoriad en Heol e-keñver hini ar c’halaksienn,
empennomp e vije hor galaksienn a-vent gant Frañs, da lavaret eo he dije
1000 km treuzkiz. Neuze e vije Koskoriad en Heol a-vent gant ur pezh ur
santim euro. Gant ar binvioù modernañ zo ganimp evit beajiñ en egor, e vije
ezhomm eus 15 vloaz d’un astraer da vont eus an Douar (kreiz hor pezh 1
santim euro) betek Ploudon (lezenn ar pezh). Evit tizhout ar steredenn dostañ
d’an Heol (Alpha Centauri) war-hed 43 metr, ez istimer e vije ezhomm eus ur
veaj 100000 bloaz, hag evit treuriñ ar c’halaksienn e vije ezhomm eus
un nebeud miliardoù a vloavezhioù.
« Pour nous faire une idée de la taille du système solaire par rapport à celle de la galaxie,
imaginons que notre galaxie soit de la taille de la France, c'est-à-dire qu’elle aurait
1000 km de diamètre. Alors notre Système Solaire serait de la taille d’une pièce d’un
centime d’euro. Avec les moyens les plus modernes dont nous disposons pour voyager dans l’espace, il faudrait
plus de 15 ans pour qu’un astronaute se rende de la Terre (le centre de notre pièce 1
centime d’euro) à Pluton (le bord de la pièce). Pour atteindre l’étoile la plus proche
du Soleil (Alpha Centauri) distante de 43 mètres, on estime qu’il faudrait
un voyage de 100000 ans, et pour traverser la galaxie il faudrait
quelques milliards d’années »
Source* : D.Bottineau (Université Paris X)